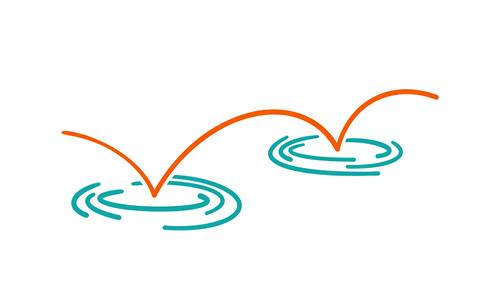Les grandes approches des démarches de prospective
Notre volonté est de démocratiser l'accès aux démarches de prospective. Car ces démarches ne sont pas réservées à quelques consultant.e.s et doivent être accessibles même si l'on ne dispose pas de gros moyens et de beaucoup de temps.
Il nous semble important de partir de la pratique des acteurices de terrain pour amener progressivement les ingrédients et étapes de la prospective dans leurs pratiques.
Il nous semble important de partir de la pratique des acteurices de terrain pour amener progressivement les ingrédients et étapes de la prospective dans leurs pratiques.
Télécharger les ingrédients et étapes en format A3
Des ingrédients à saupoudrer 🍫
Faire de la prospective, c'est saupoudrer dans ses pratiques divers ingrédients particuliers. Et comme dans toute bonne recette, c'est meilleur quand ils sont tous présents mais ça n'empêche en rien de se passer de l'un ou l'autre d'entre-eux (ou de le rajouter par après)

Pour aborder la notion du temps long
Appréhender la notion du temps et singulièrement le temps long est compliqué pour la pensée humaine. Or, il est au coeur de toute démarche de prospective.Le temps long est le seul sur lequel peuvent réellement être engagées les actions en profondeur.
Dans tout système, coexistent des variables empreintes d’une grande inertie avec d’autres dont les variations interviennent sur des échelles de temps de plus en plus courtes. Seule l’analyse sur longue période permet d’éliminer les « effets de période » et d’appréhender la dynamique profonde des systèmes, d’analyser, à l’abri de la tempête, les ressorts profonds de l’évolution.

Pour prendre en compte des signaux faibles, repérer des bifurcations
Sans la capacité de détecter, de vouloir voir, ces petits signes qui, à côté des tendances lourdes, sont les germes, les points de rupture, les possibles bifurcations des futurs en construction, il sera difficile de s'engager dans une démarche de prospective.Ces signaux faibles résultent de facteurs aussi divers que :
- les effets de seuil ;
- l’irruption d’innovations de toutes natures et d’acteurs " briseurs d’habitudes " ;
- la volonté humaine de modifier les règles du jeu
- ...
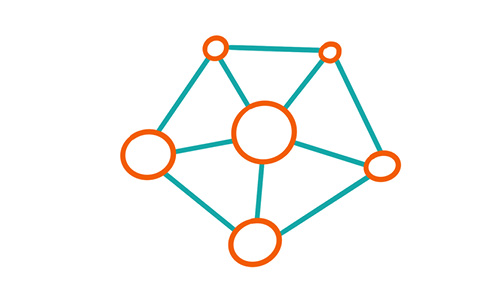
Pour tenir compte de la pluridisciplinarité
Partant du constat élémentaire que les problèmes auxquels nous sommes confrontés ne sauraient être réduits à une seule dimension et correctement appréhendés lorsqu'on les découpe en rondelles, la prospective se propose d’appréhender les réalités au travers de l’ensemble de leurs aspects, de toutes leurs variables, quelle que soit leur nature.Empruntant très largement à l’analyse des systèmes, elle nous invite à considérer les phénomènes à partir d’une étude de l’ensemble des facteurs et de leurs inter-relations.
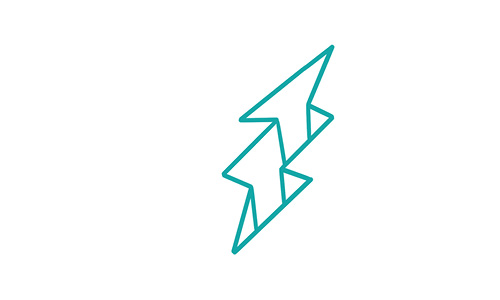
Pour sortir des ornières et des lieux communs
Il nous faut rester vigilants par rapport au conformisme du consensus pour maintenir au maximum ouverts les possibles et sortir des ornières des pensées toutes faites.Le regard que nous portons sur la réalité est souvent faussé par :
- Les outils d’observation qui sont les nôtres ou nos sources d’information
- Les instruments de mesure que nous employons, (PIB ?)
- Le poids des théories à partir desquelles nous croyons pouvoir expliquer la réalité
- L’influence des idéologies qui bien souvent occultent la réalité
- Les biais cognitifs qui nous font prendre inconsciemment de dangereux raccourcis
- ...

Pour un futur co-construit par les parties prenantes
Les démarches prospectives doivent être inclusives si nous les voulons émancipatrices. En effet, il faudra être vigilant à un « accaparement du futur » par une bulle culturelle, qui déciderait du futur "pour tout le monde".Aussi la démarche prospective est avant-tout un cheminement intellectuel qui vise à analyser la pensée individuelle et collective. Pourquoi ce futur et pas un autre ? Pourquoi cette rupture et pas une autre ?

Pour convoquer la notion de zone de responsabilité
Gaston Berger nous invite à « considérer l’avenir non plus comme une chose déjà décidée et qui, petit à petit, se découvrirait à nous, mais comme une chose à faire ». Etre responsable, ça ne veut pas dire "être coupable" mais c'est accepter d'avoir une zone de responsabilité individuelle (et collective), c'est se donner un pouvoir d'agir.Pouvoir définir cette zone de responsabilité est un point important des démarches de prospective. Car à quoi bon imaginer des futurs souhaitables si nous n'avons rien à y apporter ?
Michel Godet distingue trois attitudes face à l’incertitude et aux potentialités de l’avenir :
- passive (subir le changement),
- réactive (attendre le changement pour réagir) et
- prospective dans le double sens de la pré-activité et de la pro-activité.
Et des étapes à prendre ou à laisser...

Définir le problème et identifier les variables-clés et les enjeux
Quel est le (ou les problèmes) à résoudre ? Quels sont les enjeux ? Une démarche prospective démarre toujours par ce point de départ. Mais comme le disait Gaston Berger, la prospective c'est avant tout une attitude qui vise à voir loin, voir large, analyser en profondeur. Il est intéressant à ce stade d'avoir une vision systémique. Quels sont les constats d'aujourd'hui, les interactions, les effets d'échelle (poupées gigognes de mon territoire à l'ensemble de la planète et inversément), les acteurs concernés, les variables-clés? Afin de ne pas restreindre trop l'éventail des possibles, et le risque de passer à côté d'impensés, il est conseillé de constituer un faisceau large et pluridisciplinaire de variables à observer, d'éviter de se perdre dans l'hyper-précision et de favoriser la robustesse et l'adaptabilité du modèle plutôt que son optimisation.
Identifier les zones de tensions
Autour de la ou des thématiques choisies, il est intéressant, dès à présent, de cartographier les espaces de frottements, de tensions, de conflits potentiels voire déjà déclarés.- Quels sont les acteurs concernés ?
- Sur quoi se cristallisent les tensions ?
- Est-ce que ces tensions sont récentes ?
- Est-ce que ces tensions se déplacent dans le temps ?
- Est-ce que ces tensions permettent des espaces de dialogues féconds ?
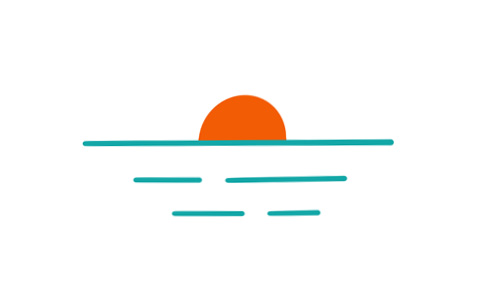
Choisir un horizon
Mener une démarche de prospective invite à travailler sur le futur mais quel futur ? Demain ? Dans 10 ans ? dDns 100 ans ? Choisir un horizon invite à trouver le bon équilibre entre assez loin pour ouvrir les possibles et assez près pour rester envisageable. De nombreux exercices de prospective globale (à différencier de la prospective sectorielle, d'une entreprise ou d'un secteur économique par exemple) prennent des échelles de 20 à 30 ans par exemple. Il est important d'essayer de se le représenter (j'aurai quel âge à cette date-là, et mes enfants ou petits-enfants, le même pas de temps en arrière ça me ramène où, il s'est passé quoi depuis, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé...)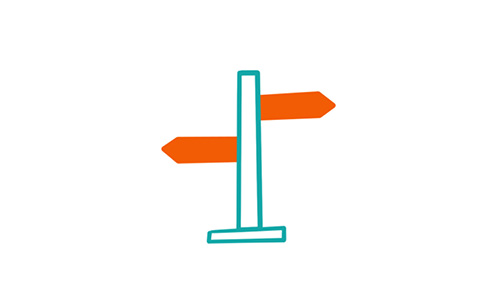
Préparer le souhaitable
Porter un regard critique sur le présent, analyser individuellement et collectivement qu'est-ce qu'on aimerait "garder" et qu'est-ce qu'on aimerait "jeter". S'inspirer par exemple du questionnaire de Bruno Latour sur le monde d'après ou de la fresque du renoncement. Entrer en profondeur pour expliciter les réponses (méthode des 5 pourquoi par exemple). Cette étape est importante dans une dynamique de prospective des futurs souhaitables. "Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va." Sénèque
Faire de la veille, observer et écouter
La veille est indispensable pour chercher les "germes" de futurs possibles. Différencier les outils de veille qui nous permettent de garder un oeil sur les tendances lourdes (analyses et indicateurs sur des temps longs) et ceux qui visent à repérer des signaux faibles (regards décalés...). L'analyse permettra d'identifier ce qui reste du conjoncturel de ce qui peut être émergent, ce qui a un "potentiel d'avenir". Des allers-retours avec le passé et le présent permettent d'affuter son regard. La veille collective est particulièrement intéressante car elle permet d'étendre la "surface observée". Le risque de la veille est de se perdre dans trop d'informations. Il est important d'arriver à se soustraire du bruit ambiant, de savoir gérer les risques d'infobésité, pour garder la capacité d'attention nécessaire à écouter les signaux faibles.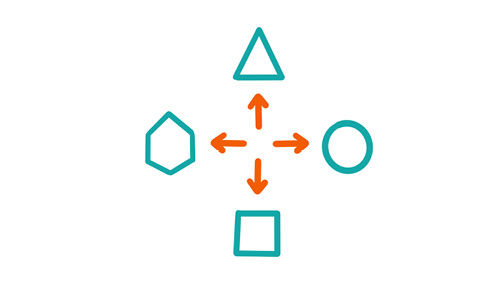
Émettre des hypothèses
Riches de notre lucidité sur les enjeux d'aujourd'hui, sur le panel de contraintes, sur nos voeux de souhaitables, sur les dynamiques d'évolution en cours et les faits porteurs d'avenir, il devient possible alors d'émettre plein d'hypothèses. Sur nos variables que l'on a identifiées, imaginons des "Et si...". On peut alors faire évoluer notre "modèle" construit lors de la première étape de définition du problème et des enjeux, en faisant jouer les différentes variables-clés identifées.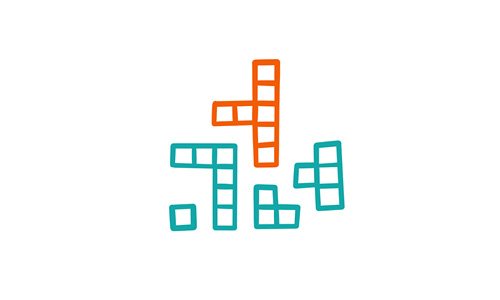
Construire des futurs possibles
Il s'agit alors de mixer les hypothèses pour construire des futurs possbiles avec des dynamiques, des interactions, des systèmes crédibles. Plusieurs méthodes existent. L'analyse morphologique, les méthodes des scénarios, etc.
Fabriquer des objets fictionnels
Élaborer des « objets » ou « artefact » pour « éprouver » les futurs possibles. C'est le domaine du design fiction, récits, images, BD, films, uchronies tout ce qui va pouvoir nous permettre collectivement de se plonger, d'appréhender, de vivre le futur possible.